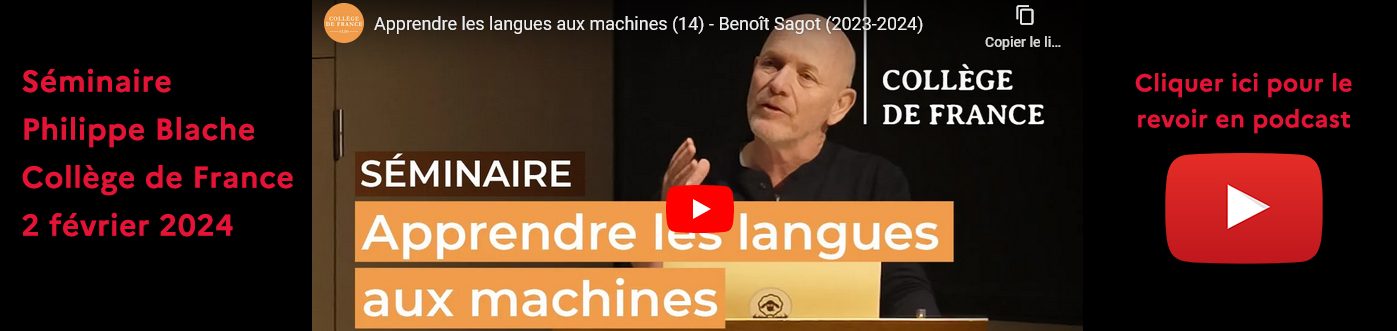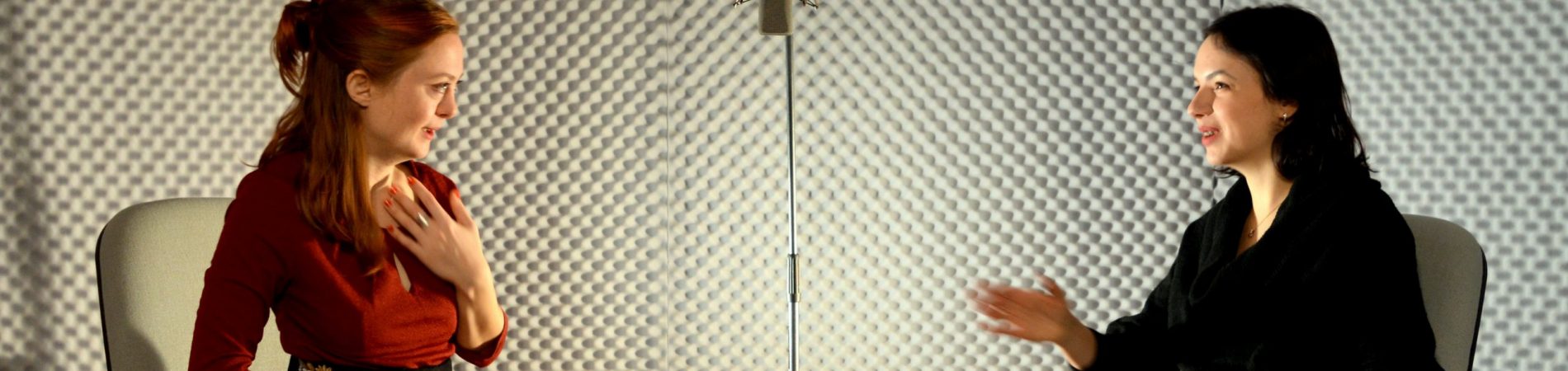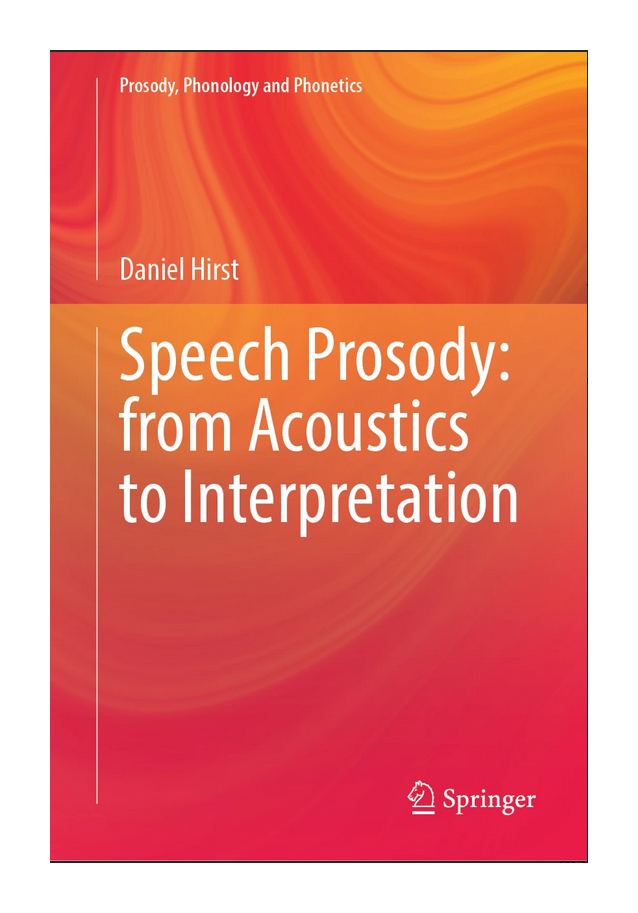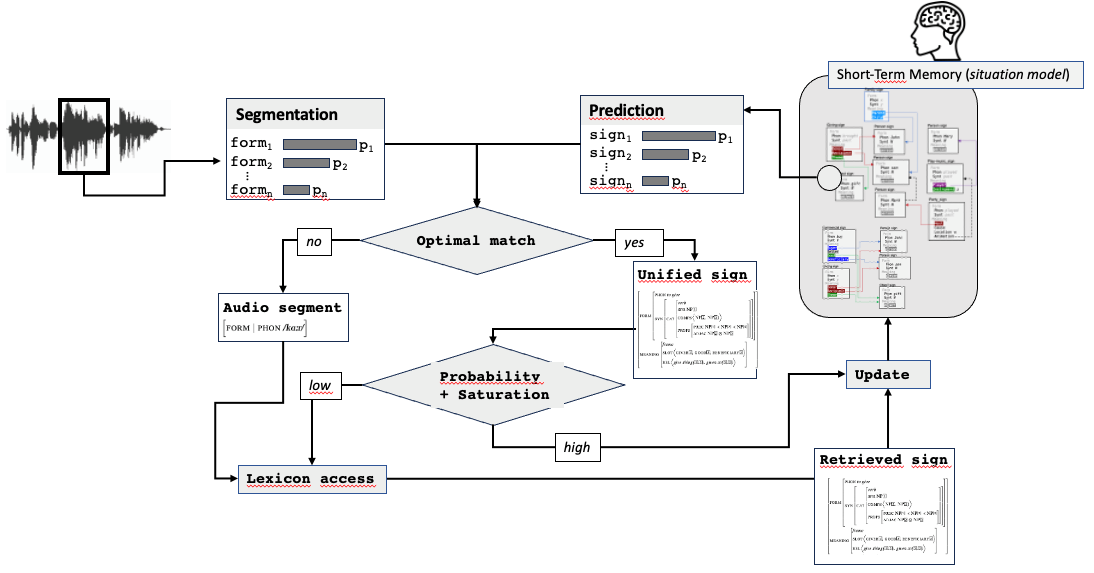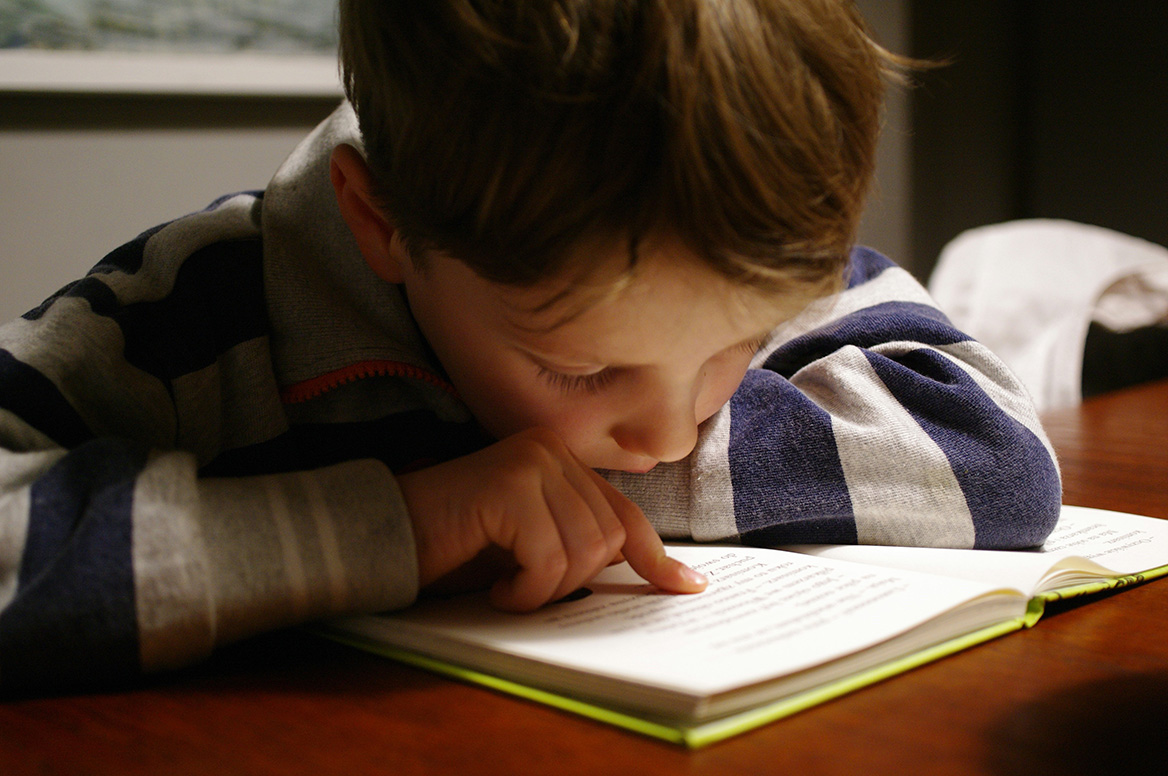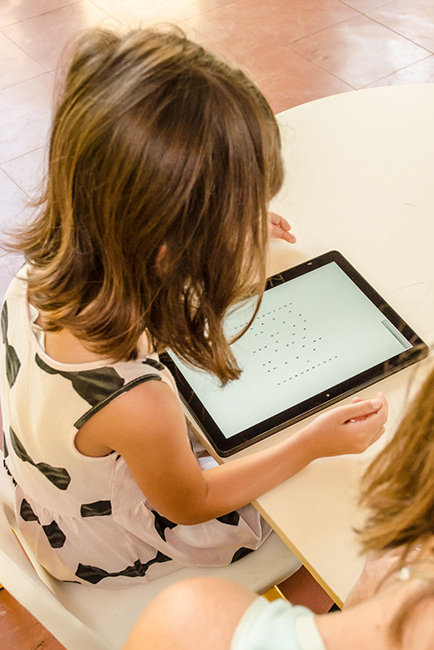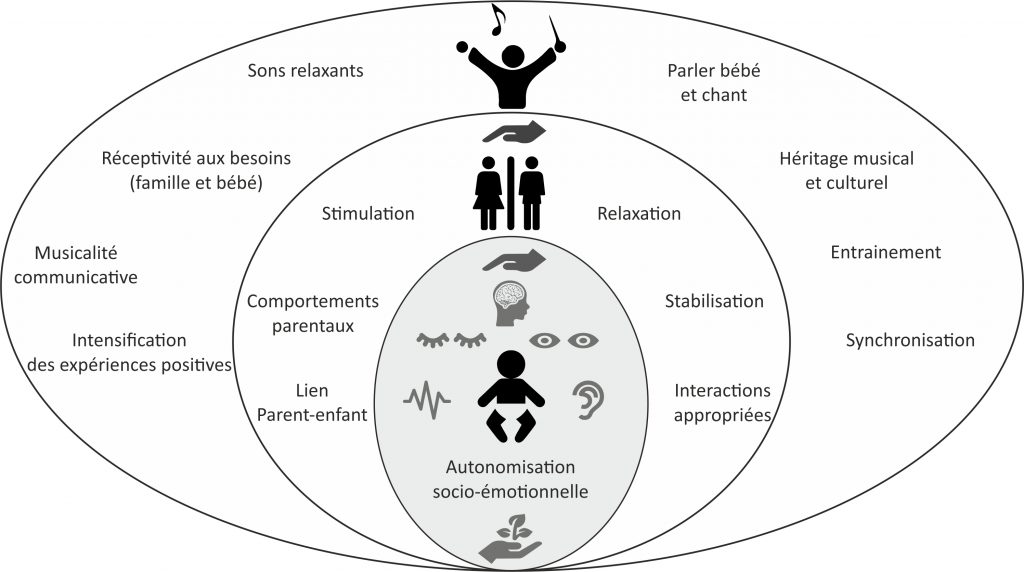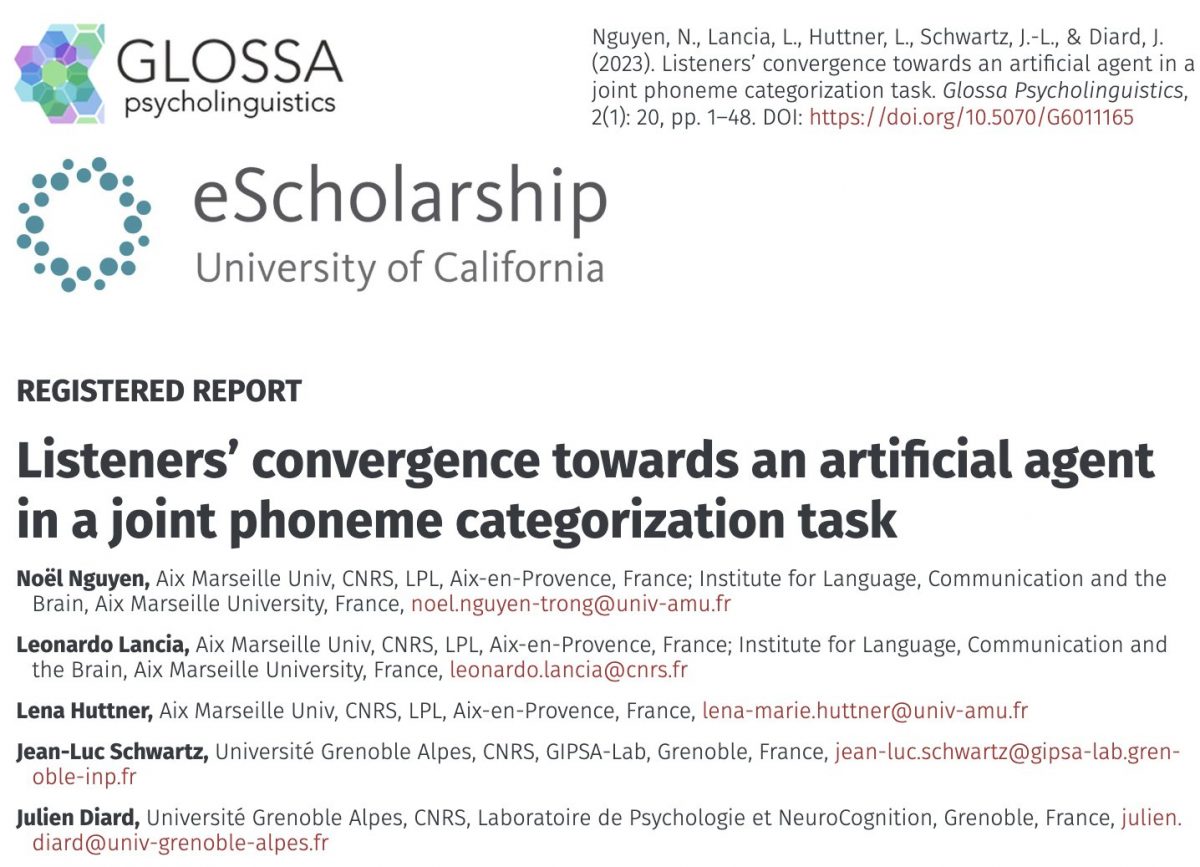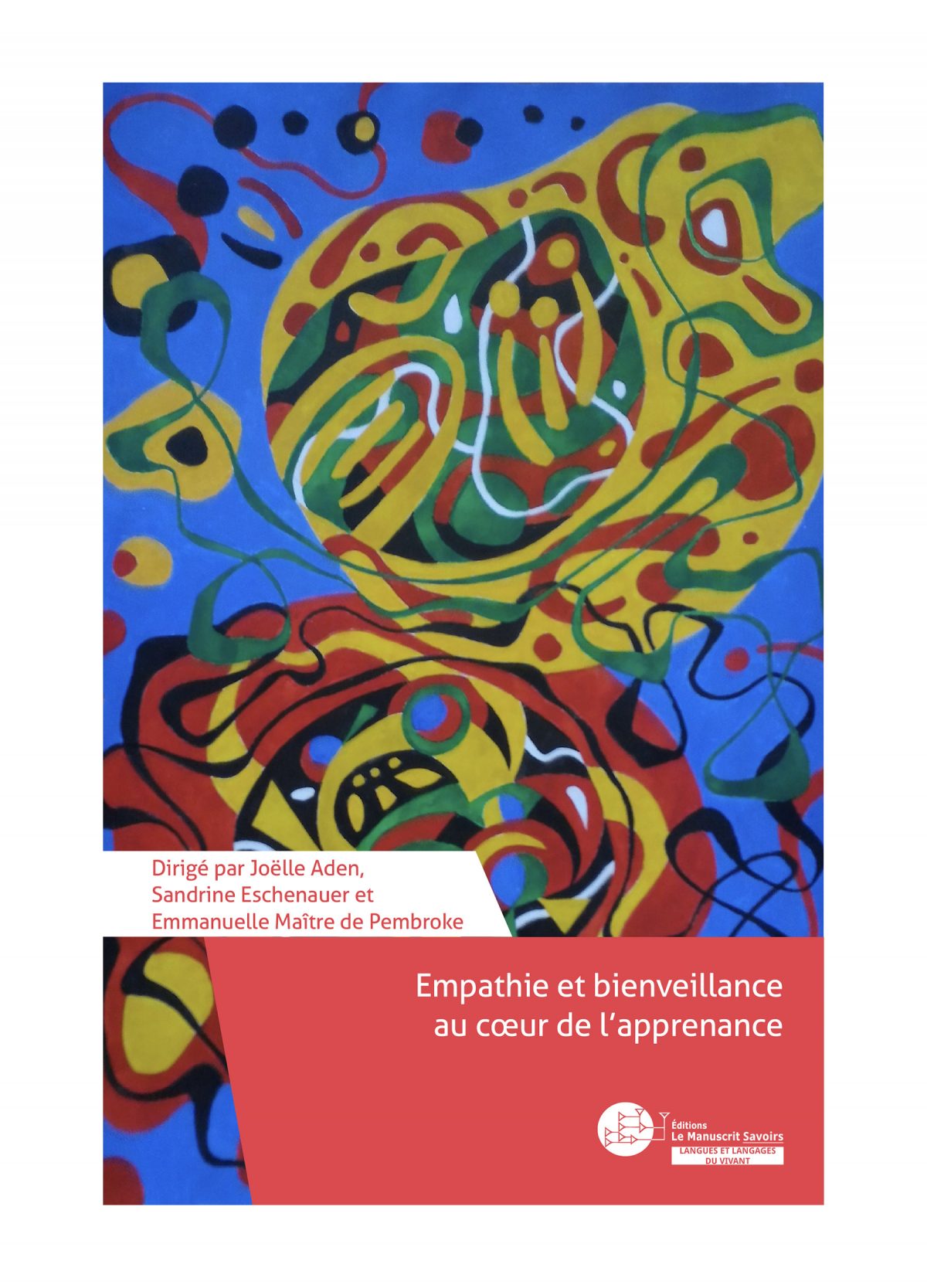Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du dernier article de Núria Gala et Marie-Noëlle Roubaud, deux enseignantes-chercheuses AMU au LPL, en collaboration avec Ludivine Javourey-Drevet du SCALab (Villeneuve d’Ascq) dans la revue « Lexique » :
Référence : Núria Gala, Marie-Noëlle Roubaud, Ludivine Javourey-Drevet. La difficulté d’apprentissage du vocabulaire de spécialité à l’école : le cas des verbes opaques. Lexique, Juillet 2024, 34. ⟨hal-04580153⟩
Article en texte intégral : https://www.peren-revues.fr/lexique/1727
Résumé :
Dans le but de mettre en lumière les lacunes dans les connaissances du vocabulaire spécifique aux textes de spécialité, nous analyserons dans cet article une série de verbes opaques (polysémiques, fréquents dans les manuels d’histoire et de sciences) et nous dresserons un bilan des connaissances lexicales d’un ensemble de 219 enfants de cours moyen (9 à 11 ans) questionnés dans différentes écoles de France. Nous montrerons, par ailleurs, quelles sont les stratégies utilisées par les élèves pour répondre à la consigne proposée : écrire une phrase avec un verbe donné hors contexte.
Crédits d’image : Drazen Zigic sur Freepik