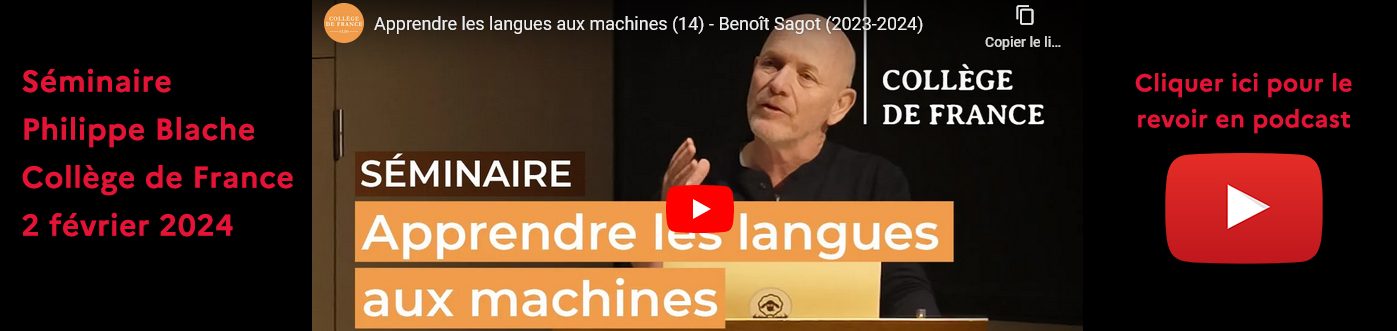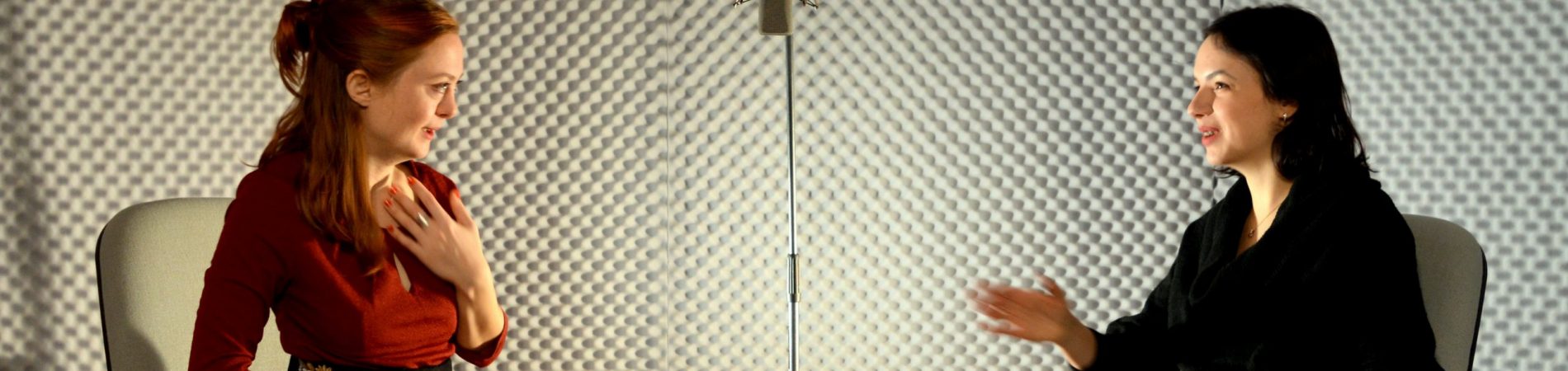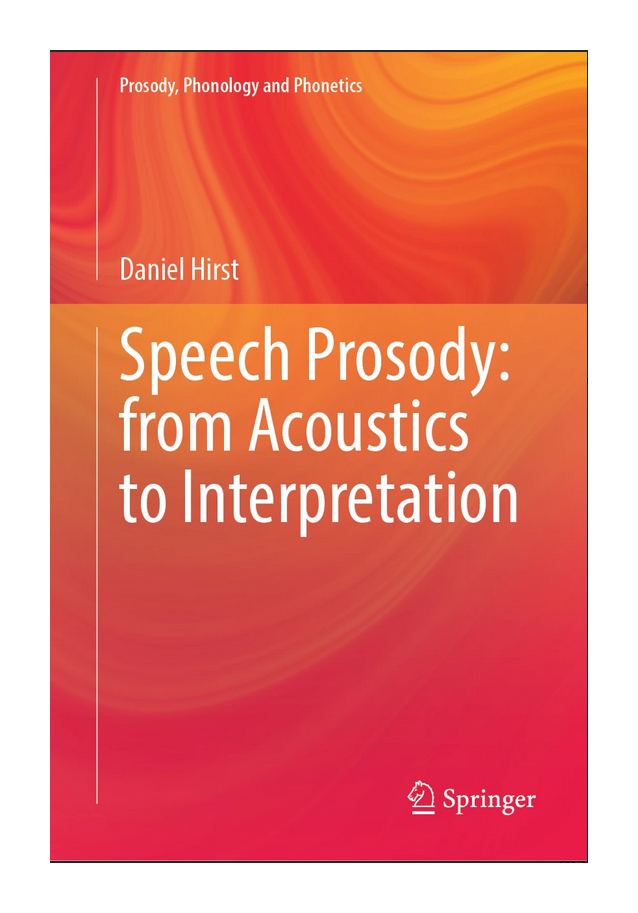Le CNRS SHS met en avant dans sa rubrique « Librarie » le dernier ouvrage écrit par Daniel Hirst, Directeur de Recherche Emérite au Laboratoire Parole et Langage, et publié en juin dernier chez Springer : « Speech Prosody: From Acoustics to Interpretation ».
Co-fondateur de SProSIG en 2000, un groupe international pour l’étude de la prosodie de la parole sous la tutelle d’ISCA et IPA, et organisateur du premier congrès international sur la prosodie en 2002 (devenu « Speech Prosody »), l’auteur y présente une vision personnelle de la prosodie de la parole en général et plus particulièrement des différents thèmes auxquels il s’est intéressé depuis plusieurs décennies. Parmi les sujets abordés, on trouvera la description acoustique de la prosodie, sa transcription, la relation entre la prosodie lexicale et la prosodie non-lexicale, la nature de la structure prosodique, la phonologie de la prosodie, la modélisation du rythme et de la mélodie de la parole et la question centrale des façons variées et parfois assez mystérieuses par lesquelles la prosodie contribue à l’interprétation des énoncés. Dans son dernier chapitre, Daniel Hirst décrit les directions qui, à son avis, seront les plus productives et fructueuses pour des recherches futures sur la prosodie de la parole.
Référence : Daniel Hirst. Speech Prosody: From Acoustics to Interpretation. Springer Verlag, Berlin. Juin 2024. https://link.springer.com/book/9783642407710