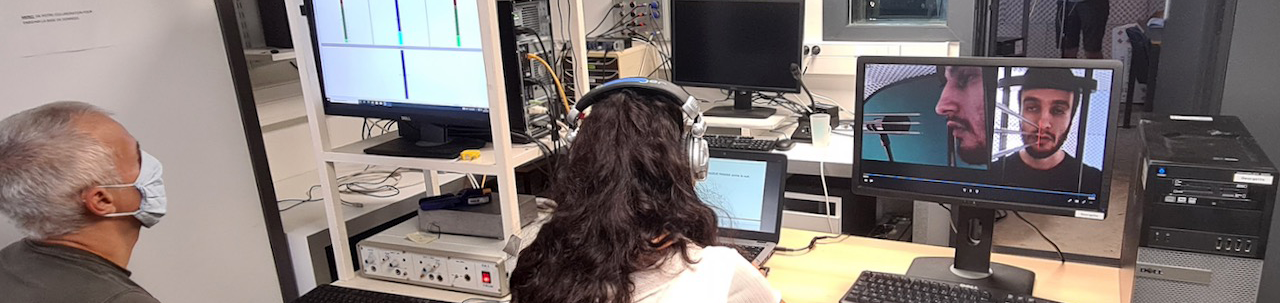Soutenance de thèse
Marie Vernet
(LPL-AMU & ToNIC-U. Toulouse)
Implication des processus perceptifs, visuo-attentionnels et oculomoteurs dans les difficultés d'apprentissage de la lecture chez les enfants atteints de neurofibromatose de type 1
sous la direction de Yves CHAIX et Stéphanie DUCROT
Vendredi 6 janvier 2023 à 10h
Salle de conférence du pavillon Baudot, ToNIC Toulouse & En ligne
Jury :
M. Bernard Lété, Rapporteur
M. Arnaud Roy, Rapporteur
M. Grégoire Borst, Examinateur
Mme Mélanie Jucla, Examinatrice
M. Yves Chaix, Directeur de thèse
Mme Stéphanie Ducrot, Co-directrice de thèse
Résumé :
La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie neurogénétique qui affecte environ une naissance sur 2 500 et dans laquelle près de la moitié des enfants présentent des difficultés d’apprentissage de la lecture. Une question centrale dans la NF1 est celle des processus cognitifs impliqués dans cette forte prévalence des difficultés de lecture, ces dernières pouvant avoir d’importantes répercussions sur la scolarité et la qualité de vie des enfants. La littérature s’accorde sur la contribution déterminante des déficits de conscience phonologique pour expliquer ces difficultés. Mais la lecture dépend également des contraintes du système visuel nécessitant le développement de capacités visuo-attentionnelles spécifiques, comme l'orientation de l’attention, le contrôle des mouvements des yeux, ou encore le déploiement du focus attentionnel. Après avoir réalisé une revue systématique des études évaluant les processus visuels dans la NF1, nous avons mené trois études afin d'examiner le rôle des processus perceptifs, visuo-attentionnels et oculomoteurs dans la genèse des difficultés de lecture fréquemment rapportées dans cette population : deux études transversales auprès de 16 enfants de 6 à 9 ans et de 42 enfants de 8 à 12 ans, et une étude longitudinale suivant 8 enfants de la maternelle jusqu’au CP. Les résultats de ces études nous ont permis de mettre en lumière le lien entre ces processus visuels et les aptitudes de lecture, les profils neuropsychologiques des enfants présentant une NF1 isolée ou avec un déficit de lecture comorbide étant différents. Les enfants NF1 avec des difficultés de lecture associées présentaient plus fréquemment un déficit des processus visuels. Ils utilisaient des stratégies de programmation saccadique immatures, comparables à celles observées chez les lecteurs débutants et dyslexiques, et se sont révélés sensibles à un outil d’aide à l’automatisation de la lecture favorisant la précision de la programmation saccadique. Les enfants NF1 sans difficulté de lecture présentaient quant à eux un fort déficit d’inhibition cognitive et pour 1/3 d’entre eux un comportement oculaire erratique. L’influence des facteurs environnementaux sur la trajectoire développementale des enfants constitue un élément plausible pour expliquer les différences de profils cliniques. Ce travail de thèse apporte ainsi de nouvelles pistes pour la pratique clinique dans le dépistage et la prise en charge des difficultés de lecture des enfants atteints de cette maladie.