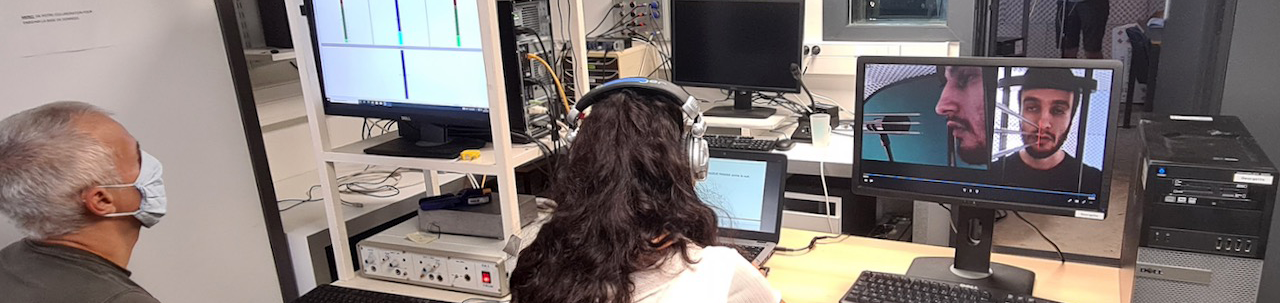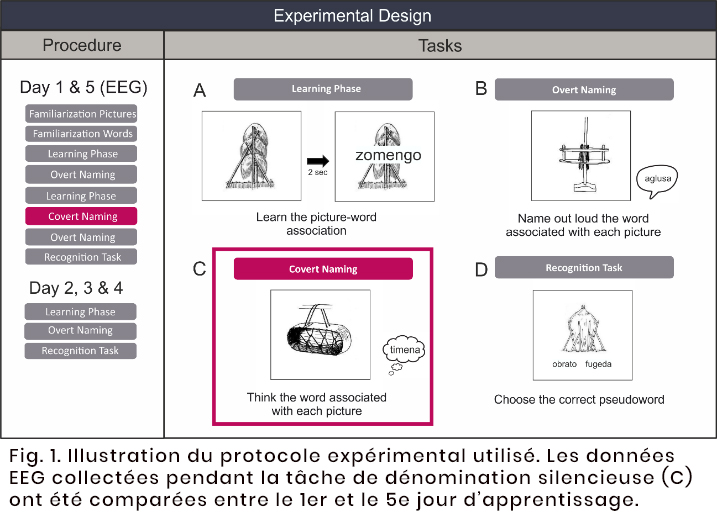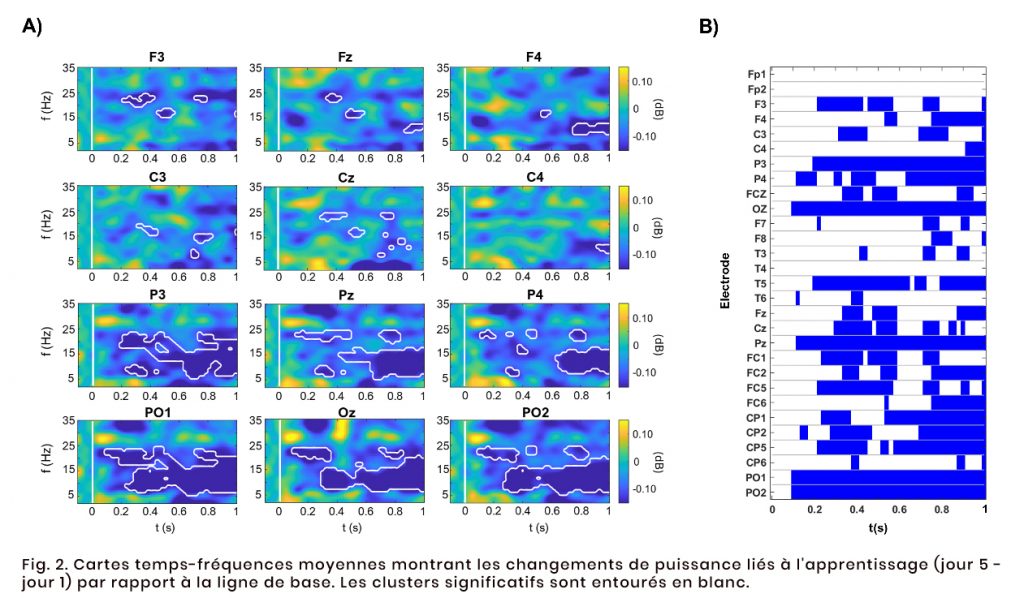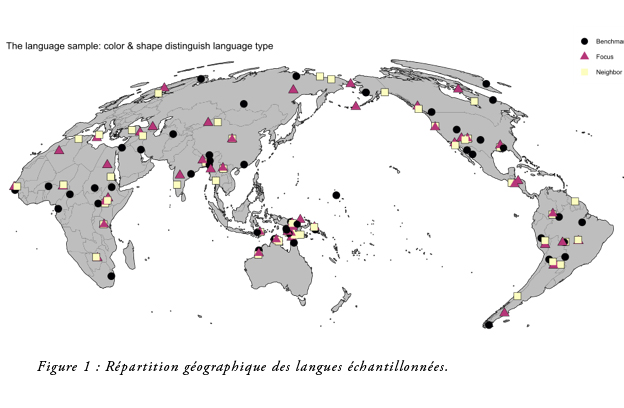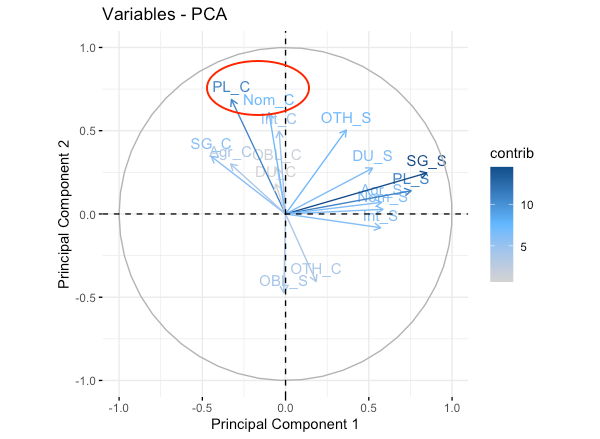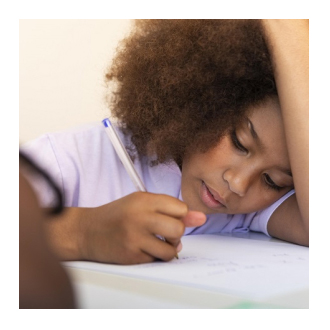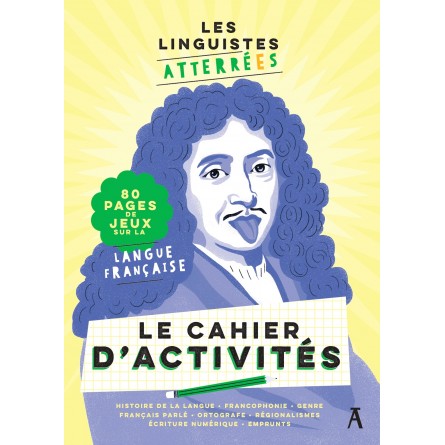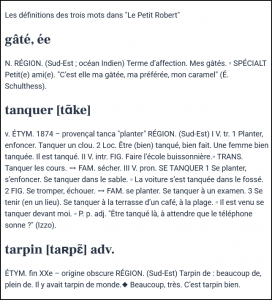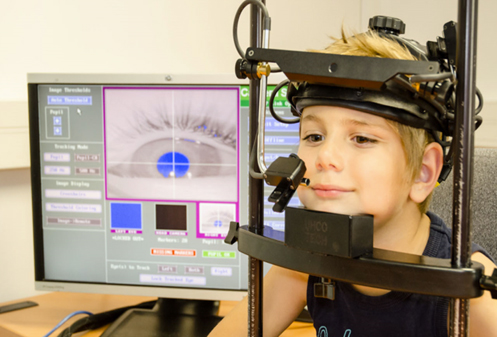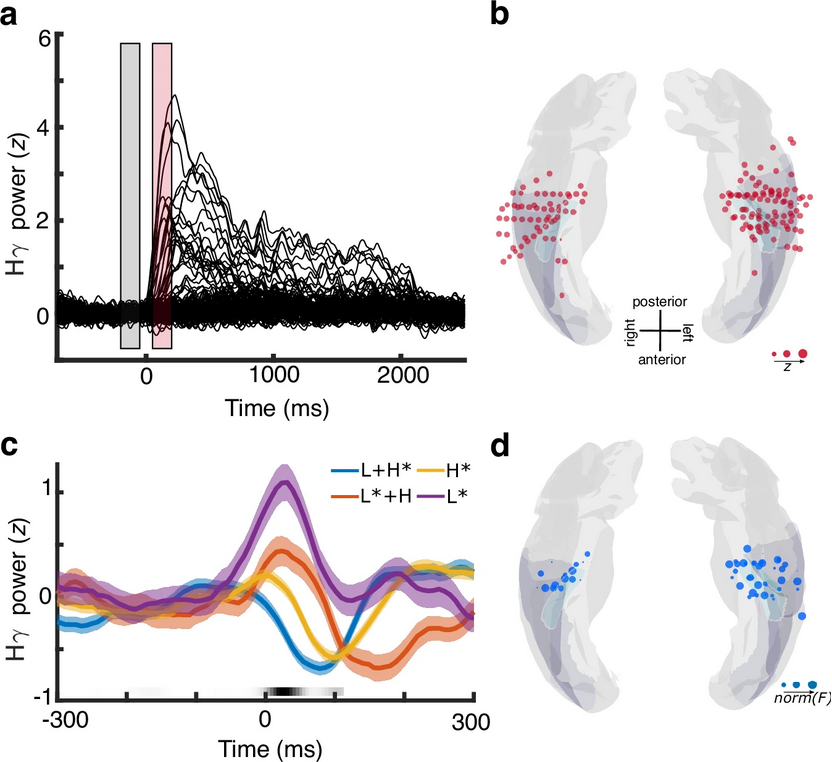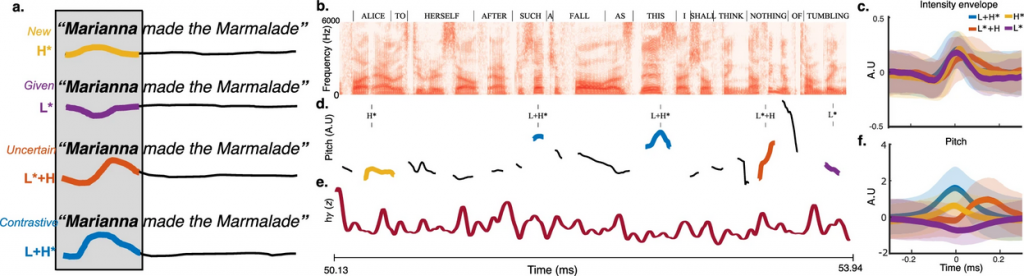Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la parution officielle du numéro 39 des TIPA : « De l’approche actionnelle à l’approche performative : quelles épistémologies, quelles méthodologies pour la recherche en didactique des langues vivantes ? »
Dirigé par Sandrine Eschenauer (LPL-amU) et Birgit Schädlich (Georg-August-Universität Göttingen), ce volume multilingue et particulièrement riche s’inscrit dans la continuité du séminaire dédié à l’exploration des méthodologies de recherche en didactique des langues vivantes étrangères, qui s’est tenu à Aix-en-Provence les 23 et 24 mars 2023. Il est disponible en accès libre sur la plateforme Open Edition Journals.
Résumé :
Ce numéro thématique des TIPA explore les liens entre approches actionnelles et approches performatives dans l’enseignement-apprentissage des langues vivantes. Si la perspective actionnelle ancre l’élève dans la tâche et dans l’agir langagier, les approches performatives, en élargissant les cadres d’expérience et d’expression, invitent à reconsidérer l’engagement corporel, émotionnel et (inter)subjectif des apprenants. À travers les contributions rassemblées, issues de travaux menés en France et en Allemagne, ce dossier interroge les épistémologies et méthodologies susceptibles de rendre compte de processus cognitifs complexes, souvent situés, sensibles et émergents. Il met ainsi en lumière le rôle que peuvent jouer les dispositifs performatifs scolaires et extra-scolaires pour favoriser la créativité et soutenir les dynamiques d’apprentissage en langues vivantes.
Bonne lecture, et n’hésitez pas à diffuser très largement dans vos réseaux !
Les éditrices du n° 39 & l’équipe éditoriale de la revue TIPA
https://journals.openedition.org/tipa/