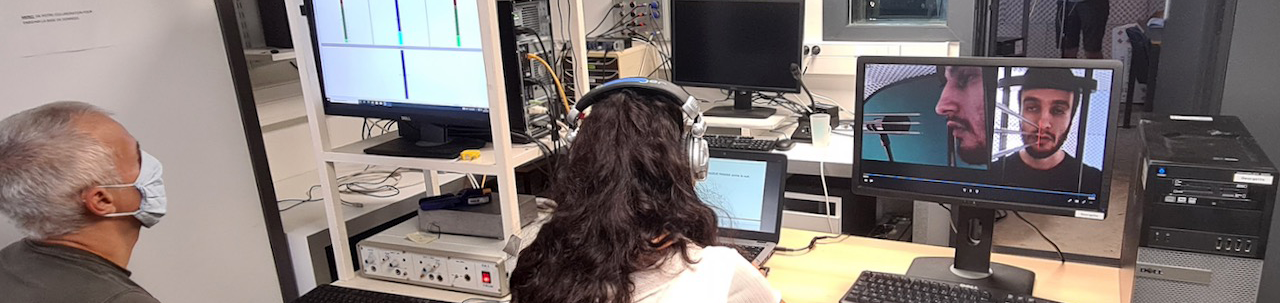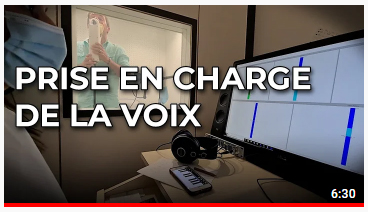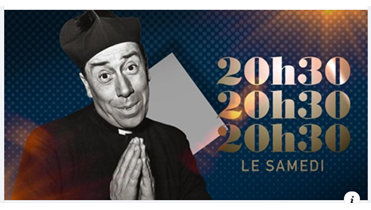Retrouvez dans le tout dernier numéro du magazine MAGMA le dossier « Comment tu parles? » (p. 18-23) suite à l’interview de Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences AMU en sociolinguistique et membre du LPL.
Dossier thématique du n° 61, automne 2021 : https://www.calameo.com/read/0048386708886bebcf861
Site Web de MAGMA : http://www.magmalemag.com/
Pour info, MAGMA est un magazine gratuit diffusé à 55.000 exemplaires destiné aux étudiants et jeunes actifs de plusieurs villes, dont Aix et Marseille. Il est notamment distribué sur les campus et lieux de vie étudiants.

Médéric Gasquet-Cyrus (AMU/LPL) et Cameron Morin (Univ. de Paris) viennent de publier un article dans The Conversation France suite à la proposition de loi relative à la « protection » et la « promotion » des langues régionales de France (« Loi Molac ») adoptée le 8 avril dernier au Parlement français.
Lire l’article : Débat : les langues régionales peuvent-elles survivre sans politique linguistique ? (theconversation.com)
____________
Par ailleurs, Médéric Gasquet-Cyrus est également intervenu dans un reportage de 13 minutes sur la discrimination à l’accent sur M6, diffusé le 2 mai dernier.

Le journal « Sciences Humaines » publie dans son dernier numéro du mois de février 2021 un dossier spécial sur le langage qui contient entre autres une interview avec Médéric Gasquet-Cyrus sur la question « N’y a-t-il qu’une langue française ? ». Maître de conférences en sciences du langage à Aix-Marseille Université et rattaché au LPL, Médéric est également chroniqueur sur France Bleu Provence. Son dernier livre « Dites-le de longue en marseillais ! » vient de paraître chez les Éditions du Fioupélan.
Interview (en fin d’article) : Ok boomer ! Ces jeunes qui inventent la langue (scienceshumaines.com)

Le 26 janvier dernier, le journal « Le Mauricien », quotidien principal de l’île, a publié un article sur les travaux de chercheurs allemands sur le créole mauricien, en mettant en avant également les études de Sibylle Kriegel. Professeure AMU et spécialiste de créoles à base lexicale française au LPL, elle évoque ici ses travaux sur les « Copies morphosyntaxiques du bhojpouri en créole mauricien » – en créole bien sûr ! – présentés lors d’un colloque en 2019.
> Lien vers l’article en ligne ou en pdf
Voici l’article de Sibylle traduit en français :
Dans le monde d’aujourd’hui, le plurilinguisme est la règle et non pas l’exception. L’immense richesse linguistique de Maurice en est une belle illustration : suite à son histoire mouvementée, la plupart des Mauriciens sont de véritables plurilingues, atout que beaucoup d’Européens leur envient ! Bien sûr, (presque) tout le monde parle le créole et comprend et écrit le français, souvent également l’anglais. Mais bien d’autres langues sont présentes. Ainsi, plus de 5 % de la population parlent le bhojpouri à la maison (chiffres de 2011). Dans ma communication intitulée « Copies morphosyntaxiques du bhojpouri en créole mauricien » j’ai essayé de montrer que ce n’est pas seulement le bhojpouri qui, depuis son arrivée à Maurice à partir du milieu du 19e siècle, a subi des influences du créole mais que l’inverse est également le cas. Ainsi, on trouve de nombreux mots du bhojpouri en créole mais il y a également des traces qui sont bien plus difficiles à repérer parce qu’ils relèvent de la grammaire. J’ai étudié deux « petits mots grammaticaux », depi et ar. Bien sûr, le mot depi vient de la préposition française depuis mais il semblerait que son fonctionnement dans le créole de certaines personnes rappelle plutôt un mot du bhojpouri : se. Pour ar les choses sont encore plus complexes : on y retrouve la trace de la préposition française avec, certes, mais également l’élément qui permet de relier deux noms en bhojpouri et qui correspond à peu près à ‘et’ en français. Un indice en faveur de cette hypothèse est le fait que le créole seychellois, pourtant si proche du créole mauricien, ne connaît pas le mot ar. Qu’est-ce que je veux montrer avec ces études un peu pointues ? Quelque chose de très simple : nous, que nous soyons linguistes ou pas, ne sommes pas du tout conscients du fait que les mots que nous utilisons au quotidien ont voyagé dans le temps et dans l’espace et qu’ils ont leur propre histoire passionnante à raconter.