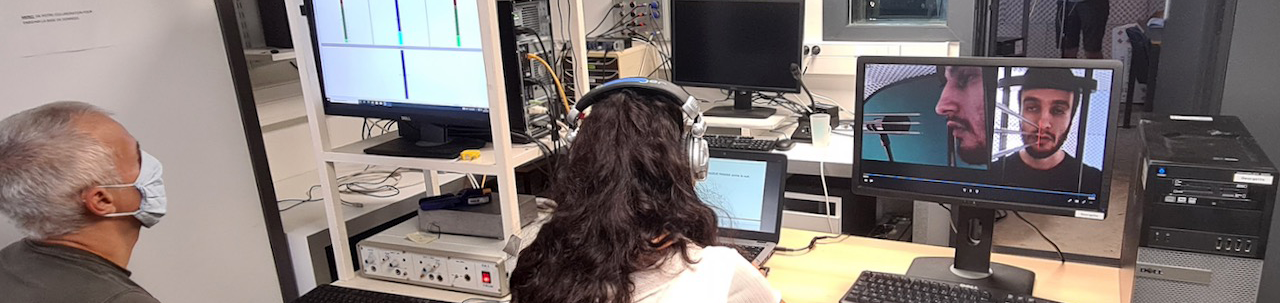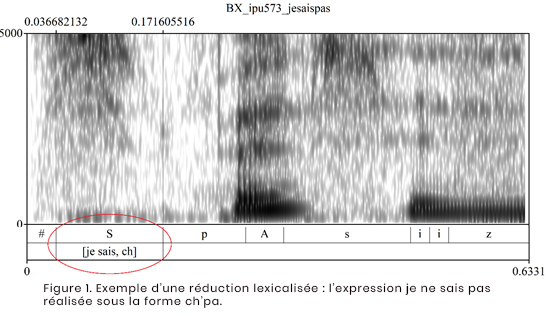Kübra Bodur vient de publier un article dans Speech Communication, en collaboration avec Corinne Fredouille, Stéphane Rauzy et Christine Meunier..
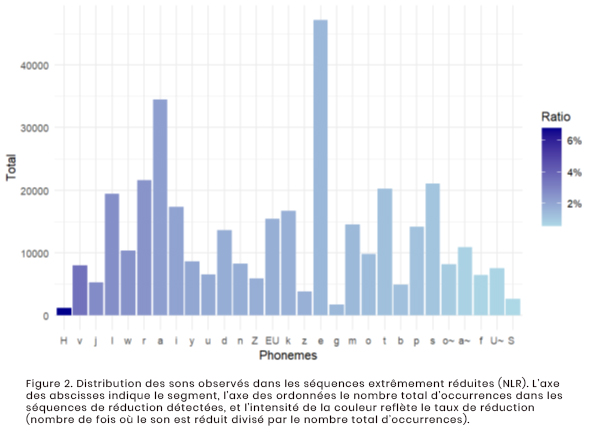
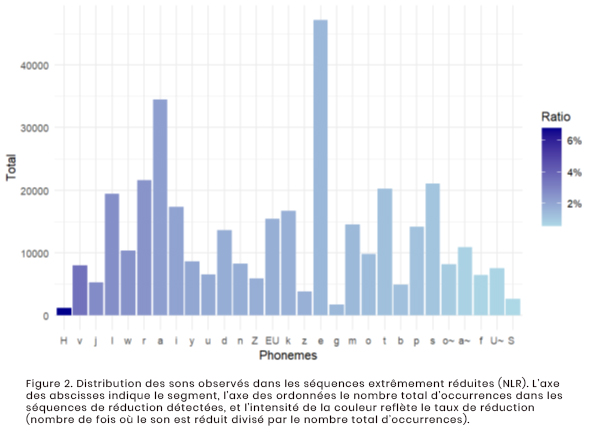
A lire aussi
Offre de poste d'ingénieur.e d’étude en expérimentation, traitement et analyse de données (h/f)
22 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Apprendre des nouveaux mots après un accident vasculaire cérébral à la naissance
16 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Lauréate de l’ERC Starting Grant 2025, Olga Kepinska est à l’honneur au CNRS
09 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Le LPL au cœur de six projets financés par l'Institut Carnot Cognition !
08 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
En quoi l’intonation révèle-t-elle les biais présents dans les questions polaires ?
18 December 2025
par Claudia Pichon-Starke
Offre de poste d'ingénieur.e d’étude en expérimentation, traitement et analyse de données (h/f)
22 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Apprendre des nouveaux mots après un accident vasculaire cérébral à la naissance
16 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Lauréate de l’ERC Starting Grant 2025, Olga Kepinska est à l’honneur au CNRS
09 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
Le LPL au cœur de six projets financés par l'Institut Carnot Cognition !
08 January 2026
par Claudia Pichon-Starke
En quoi l’intonation révèle-t-elle les biais présents dans les questions polaires ?
18 December 2025
par Claudia Pichon-Starke